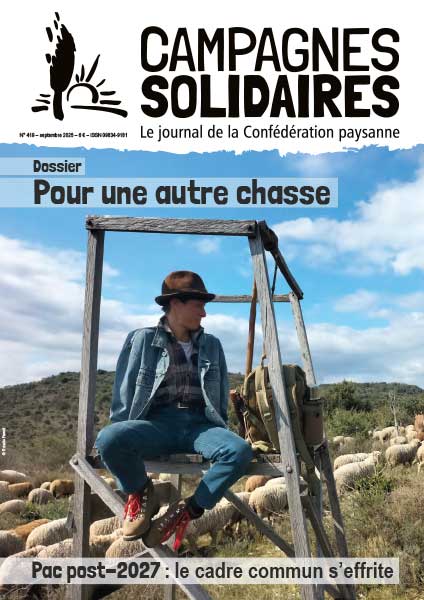Une protection sociale : comment, pourquoi, par qui ?

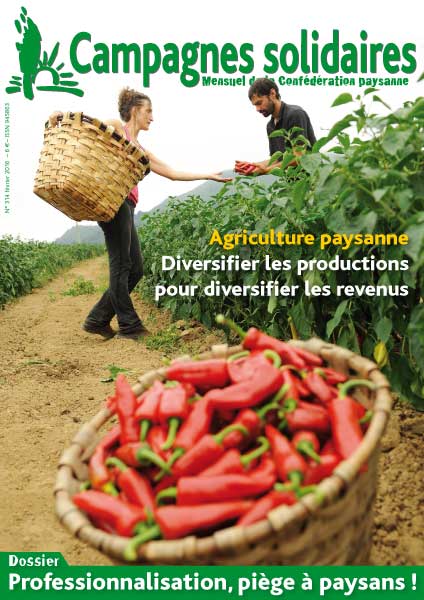 |
|
En 1945, Ambroise Croizat, ministre du gouvernement provisoire, crée la « Sécu ». Les représentants de la profession agricole de l'époque choisissent de ne pas intégrer ce régime, pas encore général, et créeront la MSA*. A l'époque, les paysan·ne·s sont très nombreux et peuvent se permettre de fonder leur propre système de protection sociale. Mais la Sécu est le résultat d'une longue histoire de luttes et d'acquis sociaux, qui n'est pas terminée.
A ma droite, une « cheffe d'exploitation » laitière, collectée par un industriel : 60 vaches, 72 ha, agriculture paysanne, climat océanique tempéré, tout herbe, autonome, cuma pour les foins, un salarié à mi-temps. Elle ne compte pas ses heures, très au-delà des 35 hebdomadaires. La Pac représente 20 % de son chiffre d'affaires. Elle déclare son revenu réel à la MSA*. A la fin de chaque exercice, son bilan comptable fait état de toutes ses charges et produits. Le système tout herbe, mis en place sur plusieurs années, est aujourd'hui efficace : son lait est plus riche, donc mieux payé. Ses charges opérationnelles ont baissé jusqu'à ne s'élever qu'au strict nécessaire. Selon son comptable, les seules charges qui augmentent sont les charges sociales. Cette année, il lui a suggéré des solutions pour amputer son résultat et ainsi baisser ces charges.
A ma gauche, un éleveur caprin : 40 chèvres, 8 ha, agriculture paysanne, climat semi-continental. Il transforme tout son lait en fromage qu'il vend en direct. Les premières années ont été difficiles. Aujourd'hui, le rythme de croisière est trouvé. Lui non plus ne compte pas ses heures. Il a démarré avec quelques chèvres sur 3 ha : il n'avait pas d'autre choix que d'être cotisant solidaire. Il l'est encore aujourd'hui. Il a très peu d'aides Pac. Il n'a pas de comptable.
Il et elle militent tous les deux à la Conf' mais en ce qui concerne la MSA*, ça gratte un peu. Ils savent que la MSA* est sous perfusion financière du régime général. Ils savent aussi qu'elle fonctionne comme une institution corporatiste, cornaquée par un syndicat majoritaire. Ils ont pendant leur carrière observé l'évolution : le système est aujourd'hui quasi identique au régime général pour les cotisations, mais pas encore en matière de prestations.
Ils ont tous les deux, ancrée dans leur conviction politique, la volonté de bâtir un système de protection sociale généralisé et émancipateur.
Elle a bien conscience que lorsque son comptable lui parle de charges sociales, il ne s'agit pas de cela. Ces soi-disant charges sont une partie de son revenu, de la valeur ajoutée qu'elle crée chaque année, versée à une caisse commune, gérée par la MSA* : des cotisations.
Alors pourquoi, le comptable (et le service des impôts, et la cuma, et le voisin...) les nomme-t-il des charges ? Pourquoi dans son bilan ces cotisations viennent amputer son revenu ?
Lui, a demandé une estimation de sa possible retraite, dans quelques années. Une misère. On lui explique que s'il ne paye pas de « charges » sociales, c'est logique qu'en retour il ne touche que très peu de prestations. Il se demande alors pourquoi on appelle encore ce système de protection sociale « redistributif par répartition », et non par capitalisation ? Pourquoi la possibilité de passer progressivement à un statut forfaitaire ou réel ne s'est-il pas mis en place plus tôt ? Et pourquoi, si elle existe aujourd'hui, n'est-elle pas accessible à tous les cotisants solidaires ? Heureusement que la vente directe lui permet de ne pas tout déclarer...
Cette paysanne et ce paysan n'existent pas. Mais ils sont un peu en chacun de nous. Qui n'a jamais pesté contre les appels à cotisation, n'a jamais ressenti l'injustice devant les prestations minimales et l'incurie des petites retraites ?
Comment reprendre la main sur un financement, un fonctionnement et une redistribution qui nous appartiennent ? Est-on prêt à remettre en cause des fonctionnements séculaires dont nous sommes aussi les acteurs ? La frontière entre bien commun et bien individuel peut bouger et faire bouger nos représentations classiques.
En 1945, la sécurité sociale a desserré la mainmise du capital sur nos vies. Elle montre encore qu'il est possible de vivre et de s'émanciper comme travailleurs, travailleuses et paysan·ne·s à part entière.
Est-on prêt à abandonner certains fondements de notre soi-disant culture pour défendre et instituer un système de protection sociale plein et entier ? La cotisation est une forme de financement encore très jeune et pour ainsi dire révolutionnaire (!). Elle a déjà prouvé son efficacité, mais elle est attaquée de toute part et parfois par nous-mêmes.
Sommes-nous bien d'accord sur les fondements de nos revendications : que défendons-nous, et comment voulons-nous financer notre protection sociale ?



 SE CONNECTER
SE CONNECTER