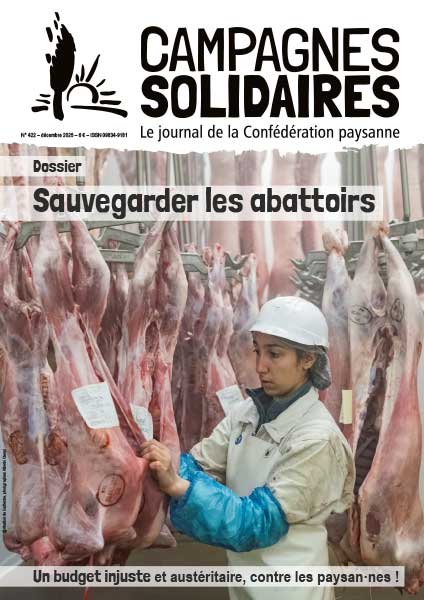PRIX : NOS POSITIONS
Prix minimum d'entrée

La situation des filières portant la proposition des prix minimum d'entrée
Le maraîchage, l'arboriculture et l'apiculture ne bénéficient presque d'aucune politique publique économiques et donc se voient abandonnés par les pouvoirs publics aux seules lois du marché. Depuis 1990, les surfaces maraîchères et arboricoles ont diminué de 150 000 hectares : c'est un tiers des surfaces qui a disparu en 25 ans. Les importations ont quant à elles augmenté de 62%. Le miel a vu sa production baisser de 45% depuis 25 ans. En 2019, on en importait 66%, soit une hausse de 28% des volumes importés depuis 2010.
Ce n'est donc pas un hasard si c'est dans ces secteurs qu'a émergé la proposition de « Prix minimum d'entrée » pour les produits importés.
Privé.e.s du soutien de la PAC*, l'objectif des prix minimum d'entrée est de proposer un mécanisme protecteur du revenu des paysannes et paysans en annulant l'impact nocif des importations sur le marché français, tout en incitant les systèmes exportateurs à améliorer leurs pratiques sociales et environnementales.
La majorité des produits importés provient de pays de l'Union européenne (Espagne, Italie, Allemagne…) où les réglementations sociales (droit et coût du travail) et environnementales (pesticides) permettent des coûts de production bas : il s'agit de véritables distorsions de concurrence.
Le prix minimum d'entrée serait ainsi défini comme suit :
En apiculture, deux grandes catégories de prix de revient pourraient être proposées : les miels de grandes cultures et les grands « crus ». Un travail technique de définition de, coûts de revient selon les territoires et les modèles d'exploitation est en cours auprès des instituts scientifiques apicoles.
Comment le mettre en place ?
La mise en place pratique du prix minimum d'entrée ne passera pas par le rétablissement d'une frontière physique. Des contrôles, par exemple de la DGCCRF (répression des fraudes), s'appliqueraient à toute entreprise achetant des produits agricoles. Ils porteraient à la fois sur les achats en France (pour le respect de l'interdiction d'acheter des produits agricoles en dessous de leur coût de production) et sur les achats réalisés à l'étranger (pour le respect du prix minimum d'entrée). Par ailleurs, des outils de suivi des échanges intra-européens déjà existants (ex : TVA, déclarations d'échanges de biens) seront mobilisés par les services des Douanes.
Les avantages du prix minimum d'entrée par rapport aux autres outils douaniers :
La question de la hausse des prix des produits frais pour les familles les plus pauvres :
A court terme et sans changer les circuits de distribution (et en particulier la répartition des marges imposée par la grande distribution), la mise en place de prix minimum d'entrée se traduirait mécaniquement par une inflation des produits agricoles, importés ou non. La mise en place de prix minimum d'entrée doit donc être couplée avec d'autres politiques publiques, et en particulier des politiques publiques ambitieuses permettant de lever les autres obstacles à la relocalisation. Une sécurité sociale de l'alimentation, que défend la confédération paysanne et d'autres, pourrait être l'une d'entre elles.
Ainsi, les prix minimum d'entrée peuvent être vus comme le premier pilier du triptyque « Protéger, installer, socialiser » que défend la Confédération paysanne depuis la crise sanitaire. De la même manière, les prix minimum d'entrée ne seront pas suffisants pour assurer à eux-seuls la sortie des pesticides, la juste répartition des moyens de production ou encore la fin de l'exploitation de la main d'œuvre étrangère. En supprimant la pression sur les prix exercés par les importations, les prix minimum d'entrée sont toutefois une condition nécessaire pour permettre une transition agricole.
A télécharger
 |
||



 SE CONNECTER
SE CONNECTER