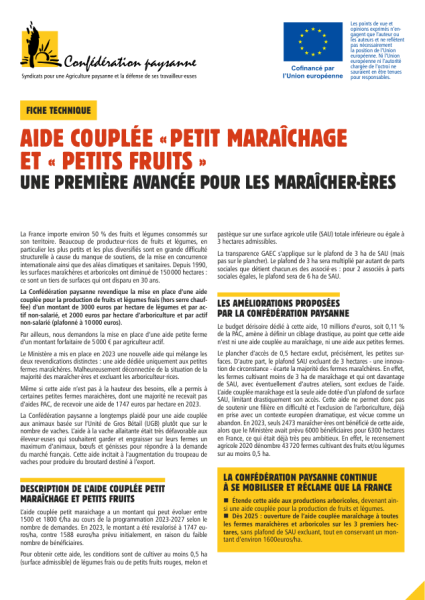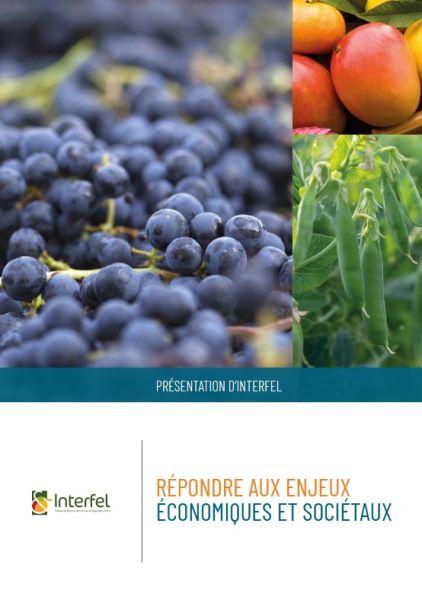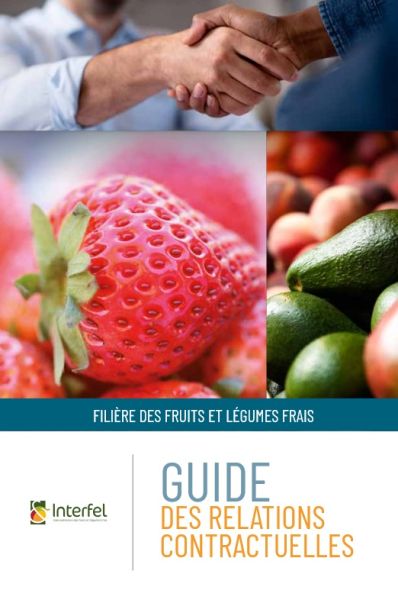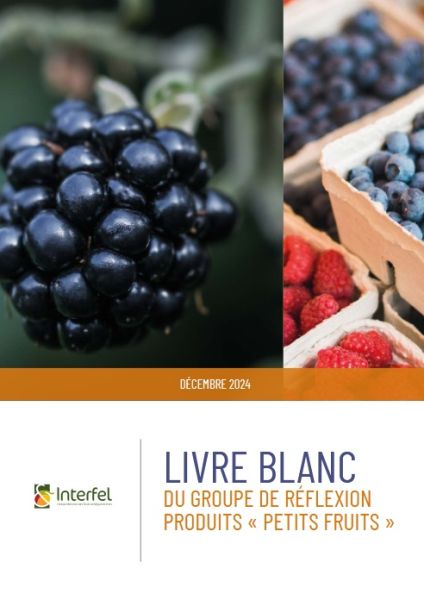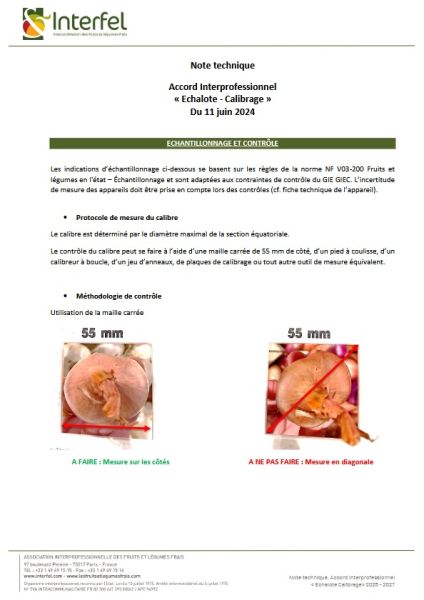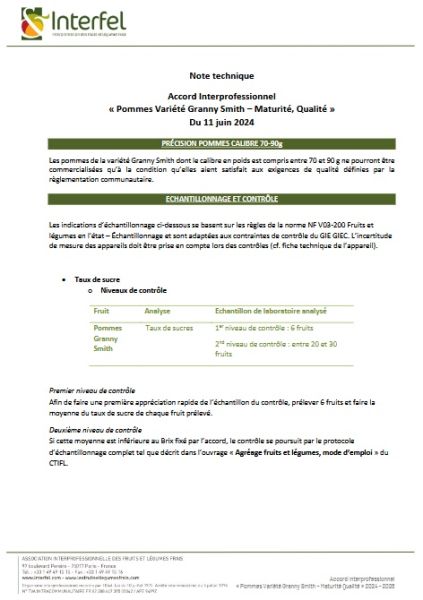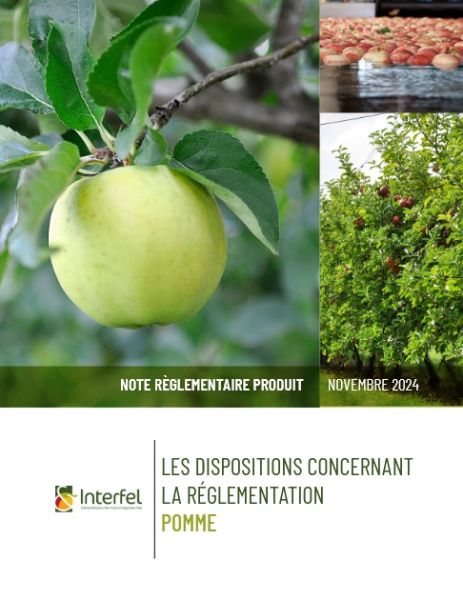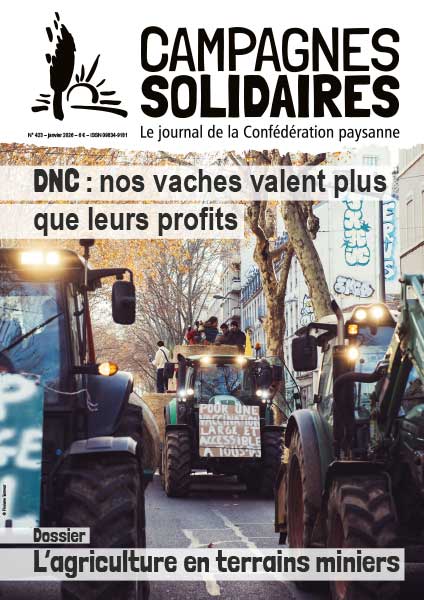FRUITS ET LÉGUMES : NOS POSITIONS
Pour un changement de système !

Oublié des politiques agricoles, le secteur des fruits et légumes subit une crise grave et durable. Depuis 1990, les surfaces maraîchères et arboricoles ont diminué de 150 000 hectares, c'est un tiers des surfaces qui a disparu en 25 ans !
Les importations de fruits et légumes ont augmenté de 62 % depuis 1990. Ces importations sont, pour les deux tiers, des fruits et légumes cultivables en France métropolitaine dont les surfaces ont drastiquement baissé. Ainsi, 49 % des fruits et légumes commercialisés en France sont désormais d'origine importée. Le constat n'est guère meilleur pour les produits certifiés Agriculture biologique : 20 % des légumes bio et 45 % des fruits bio sont importés. La majorité des produits importés provient de pays de l'Union européenne (Espagne, Italie, Allemagne…) où les réglementations sociales (droit et coût du travail) et environnementales (pesticides) permettent des coûts de production bas : il s'agit de véritables distorsions de concurrence. Si cette tendance perdure, plus de la moitié des fruits et légumes consommés en France seront d'origine importée d'ici deux ans.
Les incidents climatiques et sanitaires se sont multipliés ces dernières années, avec d'énormes dégâts sur les cultures (ex Tempête Eunice au printemps 2022, ou encore Ciaran et Domingo à l'automne 2023). Ces aléas accroissent la volatilité sur les volumes produits et sur les prix payés aux producteurs, d'autant plus qu'ils sont également tributaires des récoltes des autres pays. Par exemple, en 2017, les grandes surfaces françaises ont profité d'une récolte abondante et tardive d'abricots en Espagne, afin de maintenir un prix bas pour la faible récolte d'abricots français touchée par le gel.
L'imposition de prix bas et volatils restreint aux marchés « de niche » les initiatives de sortie des pesticides et d'amélioration de la qualité des produits. Pourtant, 84% des Français sont inquiets des résidus de pesticides dans leur alimentation.
Face à la forte pression sur les prix créés par les importations et dans un objectif de réduction des coûts, l'industrialisation de la production de fruits et légumes s'accélère. La multiplication des incidents climatiques et sanitaires et la demande sociétale sur les pesticides sont des justifications souvent utilisées par les porteurs de projet de ces fermes-usines, comme les serres chauffées de tomates sur plusieurs hectares qui se multiplient. Produites en hydroponie et en environnement fermé toute l'année, grâce à la chaleur d'un incinérateur et au recours massif à de la main-d'œuvre précaire, ces tomates de qualité gustative médiocre s'imposent sur le marché français avec des labels du type « zéro résidu de pesticides » ou « protection biologique intégrée », trompeurs pour les consommateurs.
La création et la multiplication des circuits courts de distribution dans tous les territoires est une solution aux problèmes de marché rencontrés par les paysan·ne·s en circuits longs. Les stratégies individuelles de vente directe permettent bien souvent d'améliorer la rémunération des paysans, en particulier lorsque ceux-ci sont sur de petites surfaces et se dégagent le temps nécessaire pour maîtriser la commercialisation. Toutefois, dans de nombreux territoires, l'offre en fruits et légumes en circuits courts (souvent bio) devient supérieure à la demande.



 SE CONNECTER
SE CONNECTER



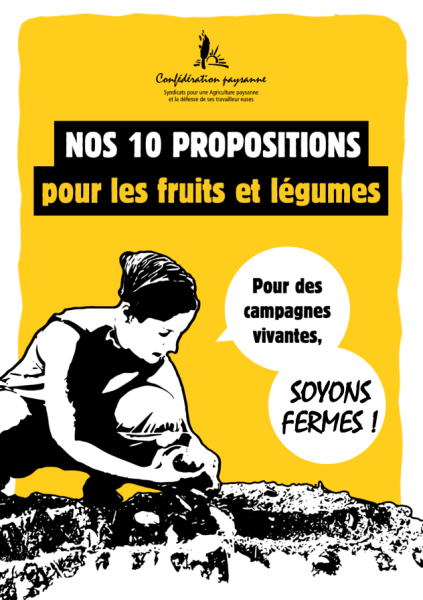
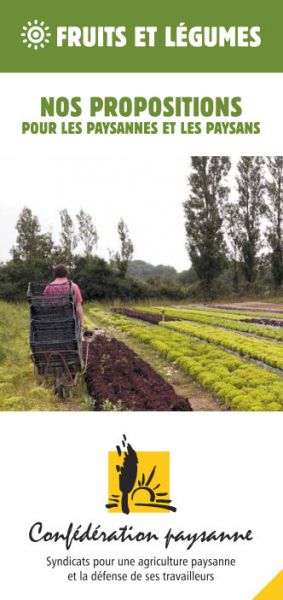
.png)